Nous n’avons jamais consommé autant de musique. Les réseaux numériques nous donnent accès instantanément aux catalogues de chansons créées par des millions d’artistes.
En même temps, les artistes d’ici n’ont jamais fait si peu d’argent. Les habitudes de consommation changent énormément. Nous sommes passés rapidement du CD au téléchargement numérique puis au streaming, qui s’implante rapidement comme étant le mode de distribution d’aujourd’hui et j’ose prédire de demain.
Une industrie qui change rapidement
Dans les bonnes années, il s’est vendu jusqu’à 13 millions de disques compacts par année au Québec. De ce nombre, un peu moins de la moitié étaient d’artistes d’ici. Un bon vendeur décrochait un disque d’or à 40 000 unités. Pierre Lapointe a vendu 160 000 copies de son album La forêt des mal-aimés, paru en 2006. Un disque se vendait moins de 20 $. Les auteurs-compositeurs touchaient environ 10 % du prix de détail, soit autour de 2 $ par album. Si on ajoute la part du producteur, c’est environ 25 % qui retournait aux ayants droit, le reste allant aux détaillants, aux distributeurs, aux transporteurs et aux manufacturiers.
Aujourd’hui, les ventes de disques physiques sont anémiques ; elles seront de moins de quatre millions de copies cette année.
Les services de musique en continu représentent maintenant la majorité des revenus de ventes de musique.
Ils remettent aux producteurs et aux ayants droit environ 70 % de leurs revenus, soit près de trois fois le pourcentage qui était remis pour une copie physique.
Des artistes qui n’y trouvent plus leur compte
Mais comment se fait-il que Pierre Lapointe ne reçoive que des miettes de la part de services comme Spotify si ses fans se nourrissent de sa musique majoritairement par l’internet ?
Voici de façon simplifiée comment fonctionne la répartition des revenus de droits reversés par Spotify : 70 % des revenus d’abonnement s’en vont dans une enveloppe qui est séparée en fonction du nombre d’écoutes de chaque chanson divisé par le nombre d’écoutes total.
On peut présumer que deux problèmes touchent la performance de la musique québécoise dans cette façon de calculer les redevances : un nombre d’abonnés québécois beaucoup moins important en pourcentage de notre population que dans d’autres régions du monde, et une sous-performance de notre musique dans les écoutes générées par les abonnés québécois.
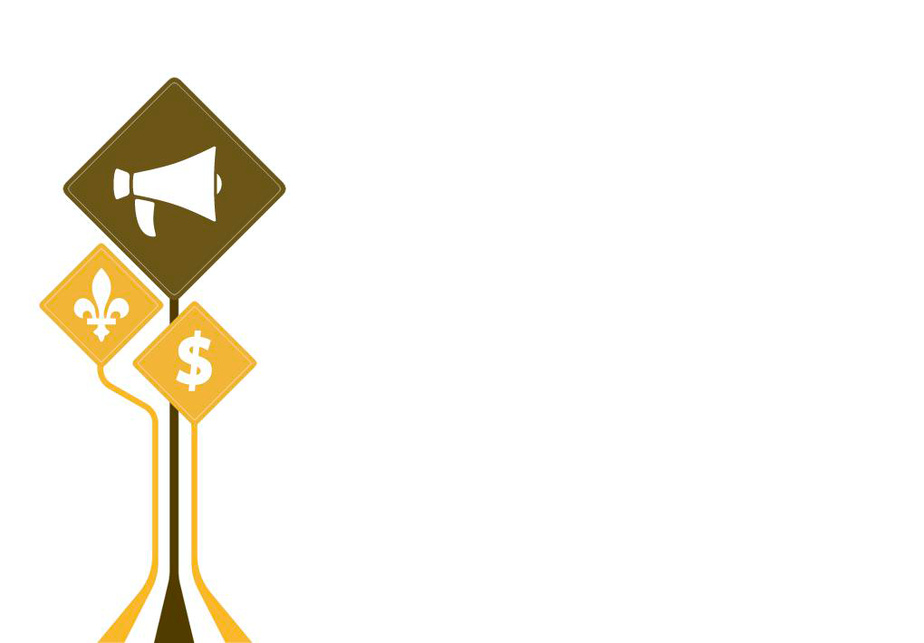
ILLUSTRATION LA PRESSE
« Des solutions existent, mais requerront un grand courage politique », insiste Alexandre Taillefer.
Spotify revendique 125 millions d’abonnés payants, dont 30 % proviennent de l’Amérique du Nord. Il apparaît raisonnable d’affirmer que moins de 200 000 abonnés proviennent du Québec. Et malheureusement, la part de marché de la musique d’ici, qui était de 45 % dans le disque physique, est beaucoup plus bas sur le numérique, probablement autour de 15 %.
En considérant un revenu d’abonnement de 10 $ par mois, ou 120 $ par année, dont 84 $ vont aux ayants droit, on en vient à la conclusion que c’est un total d’environ 1,5 million qui seront retournés dans les poches de tous les producteurs et artistes québécois par Spotify cette année. Soit environ deux fois ce que Lapointe et ses partenaires ont touché pour son deuxième disque…
***
Pour expliquer cette jachère, il importe de comprendre les éléments suivants :
L’abonnement illimité attire les gros consommateurs de musique
La consommation de musique suit aussi la règle de Pareto : 80 % de l’achat de disques disparaît par le déplacement des 20 % qui achetaient compulsivement des disques vers l’abonnement à un service de musique en continu. Et le 80 % qui achetait un album en dilettante se contente des services gratuits omniprésents, ce qui détruit l’écosystème traditionnel ;
Le contenu québécois n’est pas promu
Les pages d’accueil des services internationaux n’en font pas la promotion. Les moteurs de recherche et les listes d’écoute ne le proposent tout simplement pas. La corrélation entre le contenu promu et le contenu écouté est extrêmement élevée ;
Le spectacle sauve l’industrie musicale internationale (lire anglophone), même le plus niché
Mais ce n’est pas avec un marché extérieur de 392 millions d’anglophones que l’on fera vivre nos artistes, même les plus connus.
Sans les quotas de contenu francophone imposés dans les années 90, la musique québécoise aurait été sérieusement amochée. Il est temps de faire preuve d’un courage et d’une audace similaires et d’appliquer un remède de cheval aux règles de la musique numérique.
***
Nous devons intervenir pour sauver cette industrie et nous devons le faire avec détermination, force et conviction.
Parce que ce que nous cherchons à faire, c’est bien entendu de sauver le gagne-pain de milliers d’artistes, mais surtout de sauver la culture québécoise. Notre culture ne vivra que si elle est chantée, visionnée et lue. Si notre gouvernement a réellement à cœur sa survie, nous assurer que notre musique soit écoutée, aimée et fredonnée aura mille fois l’impact d’interdire le bonjour-hi.
On dira que la réglementation permettant une intervention de l’État tombe dans la cour des compétences fédérales. Ça va de soi. À ce titre, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, a eu raison d’aborder le rapatriement de certaines compétences du CRTC au Québec lors des dernières élections.
Parce que nos enjeux sont bien différents et beaucoup plus alarmants que dans le reste du Canada. Mais ce n’est pas demain la veille que nous nous entendrons à ce sujet avec Ottawa. Et le temps presse. Des solutions existent, mais requerront un grand courage politique.
Le plan de sauvegarde passe par deux mesures évidentes : une redevance automatique pour chaque Québécois qui se connecte à l’internet pour s’assurer que toute consommation soit rémunérée, mais aussi et peut-être surtout que des quotas de contenu québécois soient imposés aux applications locales et internationales. Notre milieu culturel n’a pas d’enjeu de production, il en a un de demande. Et elle se doit d’être influencée.
Qu'en pensez-vous? Exprimez votre opinion

