La famille Mandible, paru en poche il y a un an, décrit une Amérique future appauvrie, en crise et de plus en plus hispano-américaine. Y a-t-il un lien avec la présidence de Donald Trump ?
J’ai commencé ce roman en 2008, après la crise financière. J’ai été frappée de voir à quel point nous sommes passés proches d’un effondrement fiscal international. Il a été publié en 2017, mais ça n’a rien à voir avec Trump. Il y a un mur entre le Mexique et les États-Unis, et le Mexique l’a financé, mais c’est pour empêcher les Américains d’aller au Mexique. Je pense qu’il est évident que je n’ai pas voté pour Trump, mais j’ai décidé de profiter du spectacle. Cet homme ne sait pas écrire, George W. Bush était Shakespeare à côté de lui.
Les affrontements entre l’extrême gauche et la droite identitaire aux États-Unis ne sont-ils pas plus importants aujourd’hui qu’une crise fiscale ?
Je ne pense pas. Dans notre monde post-COVID-19, nous avons un niveau astronomique de dette publique. C’est une pyramide financière [Ponzie scheme], personne ne croit sincèrement que les États-Unis vont rembourser leur dette. Pour ce qui est de la droite identitaire, je crois que la question de la culture d’un pays est valide. Qui peut la définir et qui ne peut que l’accepter ou la refuser ? Je ne suis pas en faveur du racisme ou de l’exclusion des minorités. Mais je crois que la plupart des Américains sont d’accord pour accueillir beaucoup d’immigrants seulement s’ils ne modifient pas trop radicalement et trop rapidement la culture américaine, historiquement d’origine européenne. Les transformations que nous avons connues depuis 50 ans sont extraordinaires en un si court laps de temps. C’est beaucoup demander à la majorité que d’accélérer ces changements. Il faut faire preuve d’empathie envers les habitants d’un pays où on choisit d’immigrer.
Quelle est la genèse de Propriétés privées, paru en juin en français ?
Je crois qu’il y a un lien avec la crise migratoire de 2015 en Europe. J’ai lu une nouvelle sur un jeune homme qui s’empare de la maison de ses parents, qui ne veut pas partir et fonder son propre foyer. La leçon de tout ça, c’est que si une personne est physiquement présente chez vous, quels que soient ses droits théoriques, ils deviennent votre problème.
Certains voudraient qu’on abolisse les restrictions à l’immigration.
L’abolition des frontières, c’est très séduisant. Sauf que vous ne trouvez pas beaucoup d’Américains qui veulent changer de place avec des Africains. Les endroits où il fait bon vivre seraient envahis s’il n’y avait pas de frontières. Les dénonciations du racisme des barrières à l’immigration ont un côté ironique : pourquoi tout le monde veut-il venir ici si nous sommes si horribles ? Je suis personnellement très territoriale : chaque été pendant que nous sommes à New York, nous avons quelqu’un qui habite notre maison à Londres pour la surveiller, et je trouve ça difficile émotionnellement.
Vous dénoncez aussi l’accumulation d’objets. Aimez-vous Marie Kondo ?
Elle a raison lorsqu’elle dit qu’introduire un nouvel objet dans sa maison signifie qu’on lui cède une partie de son espace vital. Mais je ne suis pas prosélyte. Je m’intéresse à nos relations avec nos objets. Quand on achète un objet, il prend possession de nous. Je me sens responsable de ce que j’achète. Si je le gaspille, je me sens coupable, comme si je lui étais redevable. J’ai une petite cuillère avec laquelle je brasse chaque matin mon café, la même depuis 25 ans. Qui possède qui ?
Votre plus récent roman, The Motion of the Body Through Space, [qui sera publié en français l’automne prochain], parle de l’obsession pour l’exercice physique. Un écho de votre réflexion sur les objets et l’immobilier ?
Notre corps est notre possession ultime. Souvent, on le glorifie, comme on glorifie les objets et les maisons que nous possédons. On s’en sert comme une marque, pour faire de l’esbroufe, pour accéder à un autre statut social.
Donc, est-ce bien ou mal de faire de l’exercice ?
Les gens que cela obsède me lassent. Ils pensent, même s’ils ne se l’avouent pas, que cela démontre leur supériorité morale. Je fais beaucoup d’exercice, mais pour moi, c’est de l’entretien mécanique. Ce n’est pas le moment de la journée que j’aime me remémorer. Je n’aime pas en parler avec des gens au souper. Faire de l’exercice, c’est prendre soin de son corps, c’est du narcissisme. Il n’y a rien de mal à s’aimer, mais ce n’est pas une grande béatification spirituelle ou un acte noble.
Que sera votre prochain livre ?
Je l’ai terminé, il s’appellera Should We Stay or Should We Go. C’est l’histoire de gens qui décident, à 50 ans, de se tuer à 80 ans pour éviter la décadence physique des dernières années de vie. Mais rendu à 80 ans, parfois, on change d’idée. J’ai récemment connu quelques jours de douleurs atroces, si on m’avait dit que j’aurais ça pour le reste de mes jours, je ne serais plus de ce monde. Le livre est très drôle, même si ça n’en a pas l’air.
Pourquoi avoir choisi à l’adolescence de vous prénommer Lionel ?
Je ne me suis jamais reconnue dans mon nom [Margaret Ann]. J’ai voulu changer pour Tony à 8 ans. Mon choix de Lionel à 15 ans était arbitraire, je ne connaissais personne qui s’appelait Lionel. Ce n’est pas une coïncidence si j’ai choisi un nom d’homme, j’étais garçon manqué [tomboy] et j’ai grandi avec deux frères turbulents. Je m’y suis attachée parce que je l’ai choisi, un peu comme le goût américain pour la réinvention. Ce n’était pas un nom de plume ou une déclaration féministe. Je ne pense pas qu’avoir un nom d’homme change mon destin. Ça ne change pas le fait que je suis une femme.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE KIRSTIN FERGUSON
Lionel Shriver à un congrès de littérature à Brisbane, en 2016
En 2016, dans un congrès littéraire, vous avez mis un sombrero mexicain afin d’illustrer qu’un écrivain a le droit de transcender les cultures, pour attaquer les critiques d’appropriation culturelle.
À l’époque, c’était limité au monde de la mode avec les critiques des Blancs qui portaient des dreadlocks. Je voulais prévenir mes confrères de ce danger. Je veux le contrôle total sur mes personnages. C’est moi qui fais les règles. Je refuse que la gauche identitaire limite ma liberté artistique. Pour ce qui est du chapeau mexicain, je suis libertarienne, un chapeau sert à se protéger la tête, et pour un écrivain à illustrer que nous pouvons porter différents chapeaux. Je pense que c’est un scandale que ça ait fait scandale.
Extrait
« En attendant, aux yeux de la plupart des gens, on passe pour des connards. On a deux salaires, un frigo rempli et une maison avec quatre chambres dans laquelle, par principe, on ne veut plus qu’il habite. Mais quel principe ? Que c’est mieux pour lui, et pour le pays tout entier, si les jeunes démarrent dans la vie comme nous, nous l’avons fait. Mais à notre majorité, le logement et l’éducation étaient moins chers. Corrigés de l’inflation, les salaires étaient plus élevés. Donc, ce “principe” se résume à ça : on ne veut pas de lui ici. Parce que c’est chez nous, qu’on a fait notre part, et qu’on est à la limite de notre hospitalité. Parce que trop, c’est déjà trop. On peut argumenter tant qu’on veut, mais c’est quand même mesquin. »
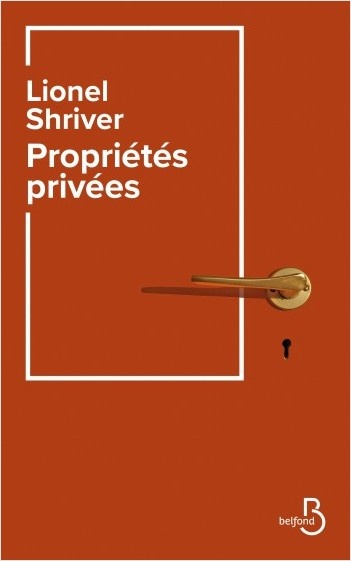
IMAGE FOURNIE PAR BELFOND
Propriétés privées, de Lionel Shriver
Propriétés privées
Lionel Shriver
Belfond
450 pages
Quatre étoiles


