Neuf ans après son dernier roman, Bret Easton Ellis revient avec un essai provocateur qui jette un pavé dans la mare d’une époque qu’il trouve trop politiquement correcte, le tout doublé d’une critique empathique de la génération milléniale néanmoins qualifiée de « dégonflée ». Nous avons parlé avec l’auteur de White, dont le titre est une façon d’assumer complètement ses réflexions d’homme blanc de 55 ans.
La critique américaine n’a pas été très tendre envers White, le premier essai en carrière du romancier Bret Easton Ellis. Mais ça ne semble pas beaucoup le déstabiliser, lui qui est déjà passé par la tempête d’American Psycho en 1992, roman jugé trop violent et misogyne qui l’a propulsé au rang de star et d’écrivain infréquentable à la fois.
Pourtant, American Psycho est aujourd’hui un des romans les plus emblématiques de la littérature américaine et son personnage principal, Patrick Bateman, est devenu l’archétype du caractère psychopathe des jeunes loups de Wall Street. Dans les meilleures pages de White, il explique la création de ce livre et le fait que le modèle de Bateman, qui n’a pas de père, est… Donald Trump, mentionné plus de 40 fois dans American Psycho.
« La réaction aux États-Unis a été très négative », reconnaît l’écrivain, que nous avons joint dans sa suite d’un hôtel à Paris, où il était en tournée de promotion. « Mais en même temps, beaucoup de gens m’ont écrit pour me dire : “Merci, bon Dieu, d’avoir écrit ceci.” Ce livre exprime des pensées qu’ils ne peuvent trouver nulle part, et ces gens ne sont pas des conservateurs. La plupart sont des libéraux. Il y a quelque chose de déconnecté dans les médias, et je pense que cela a à voir avec Trump. »
On a accusé Ellis d’être réactionnaire, de vouloir normaliser Donald Trump, d’être critique envers le mouvement #metoo et d’écrire des généralités sur les milléniaux, entre autres choses.
Dans White, qui n’est pas un essai de sociologue mais un peu un fourre-tout d’impressions de l’écrivain qui a autrefois si bien saisi sa propre génération, Bret Easton Ellis tape sur plusieurs clous : le politiquement correct, les réseaux sociaux, l’hypersensibilité des jeunes d’aujourd’hui, l’hystérie des médias et des progressistes en ce qui concerne Trump, la régression idéologique du milieu gai hollywoodien, le film Moonlight qu’on aurait célébré pour se sentir vertueux (il préfère King Cobra), Kathryn Bigelow qu’il trouve surestimée, la culture de la victimisation… Tout en défendant les dérapages « rafraîchissants » de Charlie Sheen et de Kanye West.
On lui demande s’il est conscient qu’il peut passer pour ce gars-blanc-privilégié-de-55-ans ayant l’air de dire « c’était mieux dans mon temps ». « Écoutez, j’ai grandi dans un foyer matriarcal, il n’y avait que des femmes. Mon père était parti, je n’avais pas de modèle masculin, que des femmes fortes. Ma mère, ma tante, ma grand-mère, ma sœur, mes nièces… Ce n’était pas une famille riche et elles ne se sont jamais vues comme des victimes. »
« Lorsque je parle de victimisation ou du mouvement #metoo, c’est parce que j’ai été élevé et que j’ai tellement appris de ces femmes qui ne se sont pas définies comme des victimes. Mais ce n’est pas populaire en ce moment, ça ne fait pas partie de la narration. Alors je me mets dans le pétrin. » — Bret Easton Ellis
Dans White, il raconte sans honte d’ailleurs avoir souvent tweeté soûl, sans comprendre au départ la nature de la bête. Et il estime qu’au bout du compte, « le silence et la soumission » sont ce que « la machine » veut. Ce n’est pas pour rien que, comme un Mike Ward, il s’est tourné vers la baladodiffusion, qui a en partie inspiré ce livre.
Revenez-en, de Trump
Bret Easton Ellis trouve que les progressistes ont tous perdu les pédales – et les médias, leur neutralité – quand est arrivé Trump, ce qui, selon lui, a contribué à sa victoire. Il cite régulièrement en exemple son chum Todd, beaucoup plus jeune que lui – un millénial, donc –, qui est tombé en dépression après l’élection de 2016.
« Je n’aime pas Trump, précise l’écrivain qui ne vote pas. Je ne suis pas un de ses supporters, je ne l’ai jamais été, mais il se passe quelque chose qui me fait dire que le parti auquel je pensais appartenir lui accorde trop d’attention. Je déteste le fait que mon partenaire est tellement défait par lui. Lasse-toi, que je lui dis, trouvez un autre candidat et sortez Trump de la Maison-Blanche en 2020. Au lieu de ça, j’ai subi trois ans à le voir perdre la tête à cause de ça. Je ne pense pas que c’est progressiste, je ne pense pas que ça fait bouger quoi que ce soit, c’est pourquoi je suis dur. »
« Je pense vraiment que le monde n’est pas si terrible que ça en ce moment, poursuit-il. Oui, bien sûr, le nationalisme envahit le globe, mais, en même temps, et à plusieurs égards, les gens sont mieux qu’ils ne l’ont jamais été. Les gais, les femmes, les Noirs… Mais je pense qu’il y a un nihilisme chez les progressistes et les libéraux qui disent que tout est catastrophique. Je n’aime pas ça et j’ai la terrible impression que c’est contre-productif et que ça pourrait faire réélire Trump. Plutôt que de juste ignorer le gros homme orange, de trouver un candidat et de l’éjecter du bureau, ce qu’on est en train d’essayer de faire, mais il est peut-être trop tard. »
Devenir adulte
Les pages où il parle de cinéma et de littérature sont probablement les plus révélatrices sur sa vie et sa vision de l’art. Son amour des films d’horreur vus quand il était enfant, sans surveillance, et le fait d’avoir baigné dans une culture qui était avant tout destinée aux adultes l’ont construit, dit-il.
Nous rigolons un peu au téléphone en parlant de John Waters, le réalisateur du film Pink Flamingos qui a fait scandale en 1972, un modèle de transgression. « Je pense qu’aucun de ses films des années 70 ne pourrait être fait aujourd’hui. Oui, je crois que ça nous aidait à grandir et à réaliser les terreurs du monde adulte. Ces films d’horreur m’ont vraiment aidé à accepter les désillusions de la vie adulte. C’est la vie, on en gagne, on en perd, ces films m’ont fait mieux comprendre, sur un plan métaphorique, mes problèmes, ceux de ma famille, de mon père, ma propre aliénation. Ils ne me provoquaient pas. »
C’est pourquoi il désigne les milléniaux comme la génération « wuss » (« chochotte ») dans son exigence d’être « prévenue » avant de voir quoi que ce soit. Et il se désole de les voir terrifiés par la moindre critique, dans un monde où chacun est devenu un acteur, avec les réseaux sociaux, selon lui.
« Les réseaux sociaux ne sont que performance, dit-il. Vous présentez une version de vous-même, comme les acteurs quand ils acceptent un rôle. Twitter n’est pas réel. Twitter est complètement faux. Mais pour une génération élevée devant des écrans, c’est très réel. Mon amoureux ressent facilement de la honte. Pas moi. La honte n’est pas une émotion dans laquelle ma génération baignait. Je crois que la génération de Todd, oui, et c’est une espèce d’arme, d’une certaine façon. Humilier les gens. »
L’art doit nous perturber
L’écrivain croit que trop de lecteurs ont loupé les passages où il explique sa sympathie pour les milléniaux. « Je les comprends. Je vis avec l’un d’eux depuis dix ans. Je comprends complètement ses peurs, mais je pense aussi que ce sont parfois des fantasmes. Je crois qu’ils regardent trop le monde comme une utopie progressiste. Mais la vie, ce n’est pas ça. Nous mourrons. De mauvaises choses nous arrivent. Ils ont grandi avec les attentats de 2001, les dettes d’études, les tueries dans les écoles, je comprends à un certain point qu’ils soient tombés dans un scénario de victimes. Mais je n’aime pas ça. Enfin, je n’ai jamais critiqué les milléniaux autant que j’ai critiqué ma propre génération dans des livres comme Moins que zéro et American Psycho. Le vrai problème est de ne pas accepter le monde adulte. »
Dans White, il martèle son exigence d’être perturbé par l’art. « Je pense que la moralité ne devrait rien avoir à faire avec l’art. J’ai l’impression que les milléniaux veulent apprendre des leçons par l’art. Il me semble que ma génération ne jurait que par l’esthétique, le style. L’idéologie, le message, c’était dans le style. Mon amoureux, à un certain moment, m’a accusé d’être fasciste parce que je ne croyais qu’au style, et que lui pensait que l’idéologie est le message, que la victime est le héros. Je n’ai jamais cru que la victime était le héros. »
White
Bret Easton Ellis Robert Laffont 291 pages
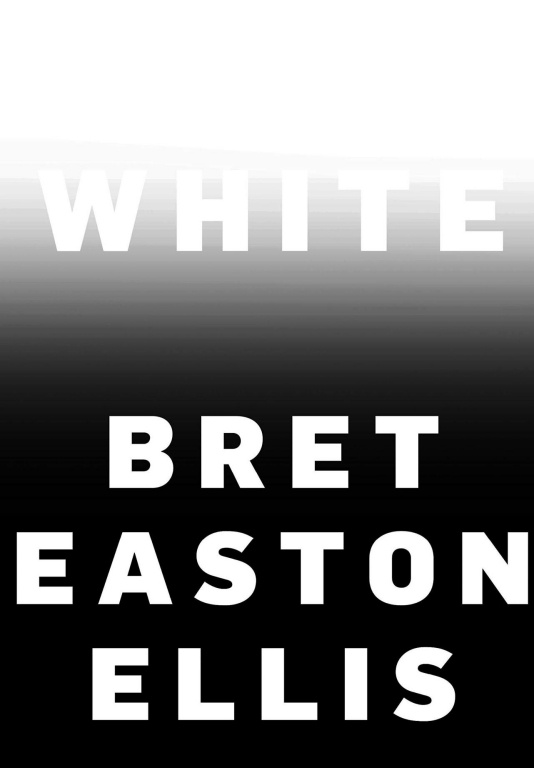
IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR
White, deBret Easton Ellis


