Dans son livre Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, paru l’hiver dernier, Zebedee Nungak explique pourquoi le Nunavik a des relations difficiles avec le reste du Québec. Il s’est entretenu avec La Presse, de son domicile de Kangirsuk, un jour où il faisait trop mauvais pour pêcher l’omble chevalier.
Q : Le sous-titre de votre livre évoque le « combat des Inuit du Québec pour leurs terres ancestrales ». En quoi ce combat diffère-t-il des autres revendications autochtones ?
R : Le Québec a acquis la souveraineté sur le Nunavik en 1912. Dans les années 30, quand la Compagnie de la Baie d’Hudson a demandé à être relevée de son obligation de fournir du soutien financier aux Inuits durant la dépression, le Québec a refusé, prétextant que c’était une responsabilité fédérale. Il a fallu les projets hydroélectriques des années 60 pour que le Québec s’occupe directement du Nunavik. J’ai rencontré, lors du lancement du livre en anglais, en 2017, un ministre québécois qui m’a dit que j’offrais une perspective différente des négociations de la Convention de la Baie-James, une perspective du terrain, de quelqu’un qui l’a négociée et l’a subie.

PHOTO FOURNIE PAR L'INSTITUT CULTUREL AVATAQ
Zebedee Nungak, auteur du livre Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes – Le combat des Inuit du Québec pour leurs terres ancestrales
Q : Vous dénoncez la francisation des noms des villages inuits. La langue est-elle une source importante de tensions ?
R : Ce n’est pas tant le français que son arrivée après 50 ans d’efforts colonisateurs pour nous faire utiliser l’anglais. C’est une langue de plus à apprendre. Et les noms anglais auxquels nous nous étions habitués ont été remplacés par des noms français, par exemple Poste-de-la-Baleine au lieu de Great Whale River, en plus de Kuujjuarapik en inuktitut. Nous sommes opprimés tant par les anglophones que par les francophones, qui se sont comportés comme les nouveaux patrons de l’endroit quand ils ont daigné nous accorder de l’attention.
Q : Les pensionnats où étaient envoyés les autochtones dans les années 50 et 60 ont-ils eu un impact sur vos relations avec le reste du Québec ?
R : Chez nous, il n’y avait pas de pensionnats francophones, tout se passait en anglais.
Q : L’une des évolutions positives que vous notez est l’introduction de l’inuktitut dans l’enseignement primaire. Qu’en est-il dans les autres communautés inuites au Canada ?
R : Je l’ignore. Nous parlons aux Inuits des autres provinces, mais nous ne suivons pas ce qui se passe chez eux. Nous avons la seule commission scolaire inuite au pays, mais ça demeure basé sur un modèle non ethnique, non inuit. Même l’enseignement de l’inuktitut ne se fait pas sur la base de notre culture. C’est admirable d’avoir ces quelques années d’enseignement en inuktitut, mais c’est très difficile de convaincre les autorités d’en faire plus. Les élèves inuits n’ont pas un enseignement suffisant de leur culture et de leur identité. Je le sais bien, je faisais partie des premiers commissaires de la commission scolaire inuite en 1978.
Q : Pouvez-vous donner un exemple d’un changement dans les écoles qui serait positif ?
R : Je suis allé deux fois au Nunavut pour visiter un centre culturel éducatif inuit à Clyde River, dans l’île de Baffin. C’est un modèle du Groenland des années 60. On mêle l’enseignement de la langue à des cours basés sur les saisons en Arctique ; ce n’est pas un système formel comme partout ailleurs au Canada. Il faut plus de temps pour l’apprentissage du territoire, des techniques de chasse, du vocabulaire inuit de la chasse, de la pêche, de la trappe.
Q : Très peu d’Inuits font des études postsecondaires. Est-ce un problème dans ce contexte d’acculturation ?
R : Ceux qui vont dans les programmes inuits du collège John Abbott à Montréal tombent souvent de haut et reviennent sans avoir obtenu de diplôme. Il nous faut augmenter le taux de réussite. J’ai personnellement bénéficié d’une expérience du gouvernement fédéral, qui avait envoyé certains étudiants inuits prometteurs à Ottawa dans les années 60 plutôt que dans les colonies dans le nord de l’Arctique, qui avaient été établies pour surveiller le territoire dans le contexte de la guerre froide. Pendant six ans, j’ai vécu comme un Blanc, en immersion totale, j’ai appris comment mange et dort un Blanc. J’y ai survécu et j’ai eu de meilleurs résultats que beaucoup de Blancs.
Q : Un autre problème du Nunavik est la crise du logement.
R : C’est un aspect permanent de la vie arctique. Il n’y a pas de solution magique. Depuis que le gouvernement fédéral a commencé à pousser les gens à quitter les campements saisonniers et les cabanes rudimentaires d’une seule pièce, nous vivons une crise du logement à cause d’un problème d’offre. Ceux qui construisent les logements ne nous consultent jamais pour connaître nos besoins. Une année, on ne construit que des maisons de cinq chambres, la suivante, des maisons d’une chambre. Au Nunavut, c’est encore pire ; au Nunavik, au moins, les maisons sont rénovées régulièrement.
Q : Serait-il possible de revenir à des camps saisonniers ?
R : Les Cris ont une période en mai où les villages ferment carrément, le congé de la chasse à la bernache [goose break]. C’est un événement culturel et linguistique pendant lequel on est complètement cri pendant deux semaines. Les règles de vie des villages civilisés ne tiennent plus. Nous n’avons pas d’équivalent de ces deux semaines en territoire inuit. Les souvenirs de ceux qui ont connu le camping de printemps où on chassait le phoque, les oiseaux, où on mangeait leurs œufs, où on vivait de la terre, s’estompent graduellement. Nous devons créer une occasion formelle de renouer avec ces traditions.
Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes – Le combat des Inuit du Québec pour leurs terres ancestrales
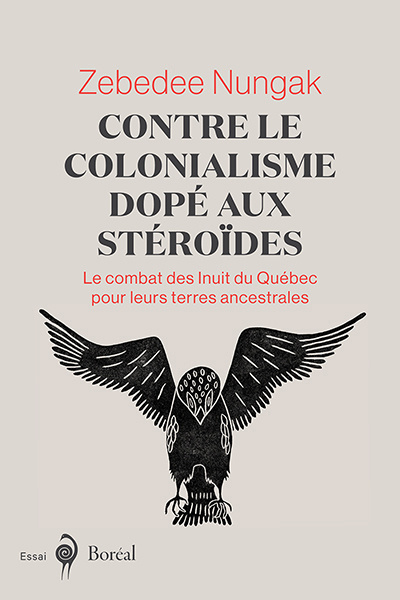
IMAGE FOURNIE PAR BORÉAL
Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes – Le combat des Inuit du Québec pour leurs terres ancestrales, de Zebedee Nungak
Zebedee Nungak Boréal 199 pages


